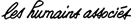 Arnaud Desjardins (suite) Arnaud Desjardins (suite)
Avez-vous rêvé de devenir moine
?
À
l'époque, j'étais déjà marié et
père
d'une petite fille de six mois. Il m'était donc très
facile de
rêver de vie monastique puisqu'il n'en était pas
question !
Vous faisiez depuis plusieurs années partie des groupes
Gurdjieff et
vous vous intéressiez déjà à l'Orient
; de quel
oeil les moines voyaient-ils cet intérêt ?
Étiez-vous
considéré comme un hérétique
?
Non,
j'étais considéré comme un être "en
recherche".
Aujourd'hui, les hôteleries des monastères ne
refusent pas
d'accueillir des personnes qui, tout en s'avouant athées ou
agnostiques,
n'en sont pas moins en recherche. Les moines voyaient donc en moi
un protestant
en quête d'une autre dimension religieuse absente dans le
protestantisme.
Je n'avais d'ailleurs nul besoin de jouer la comédie ou de
mentir pour
manisfester un intérêt profond à
l'égard des
Évangiles et de la tradition chrétienne :
l'héritage
chrétien avait et a toujours eu pour moi une valeur
essentielle que je
n'ai jamais remise en cause.
Ceci dit, j'avoue être frappé par toutes les
divergences du
catholicisme français de l'heure. Je sais, par exemple, que
dans
certains monastères, le père hôtelier
recommande à
des retraitants la lecture de mes livres tandis que dans d'autres
abbayes, on
conjure les hôtes de ne pas lire mes ouvrages qui pourraient
les
"égarer"...
Des prêtres, qui ne sont d'ailleurs nullement des marginaux
en
révolte contre l'Église, lisent mes livres et
paraissent en tirer
profit; d'autres, par contre, tiennent mes ouvrages pour
"sataniques" ou y
voient une propagande pour l'hindouisme et le bouddhisme
contribuant à
déchristianiser la jeunesse...
Les avis sont donc pour le moins partagés ! D'une
manière plus
générale, certains religieux français,
jésuites ou
dominicains, se montrent très ouverts à
l'égard de
l'hindouisme et du zen ; d'autres, cependant, réagissent
assez fermement
contre ce qui n'est à leurs yeux qu'une mode.
Votre ami abbé et les moines que vous avez connus
à
l'époque vous considèrent-ils encore aujourd'hui
comme un
être de recherche, ou ont-ils le sentiment que vous
êtes parvenu
à certaines découvertes ?
Je crois que cette
question ne
se pose pas du tout ! Ils sentent essentiellement que des personnes
autrefois
mal dans leur peau se sont trouvées plus confiantes,
rassérénées et même orientées
dans la
direction spirituelle après avoir été en
contact avec moi.
Sans entrer dans des détails relevant du secret
professionnel, je peux
même vous dire que des prêtres ont, à une
époque ou
une autre de leur vie, eu des entretiens avec moi et que j'ai pu les
aider
à se sentir de nouveau unifiés dans leur fonction
sacerdotale.
Vous disiez tout à l'heure avoir lu des écrits
ascétiques et mystiques ; à la lumière de
votre
expérience actuelle, considérez-vous que cette
plénitude
à laquelle vous êtes parvenu est du même ordre
que celle
dont ont parlé Saint Jean de la Croix ou Sainte
Thérèse
d'Avila ?
Il m'est impossible de répondre avec une
véritable certitude. Précisons que j'entends par
"certitude" une
conviction à cent pour cent, car sinon il ne s'agit plus d'une
certitude. À force de contacts vivants, d'homme à
homme (ou
d'homme à femme) avec des sages, des yogis, des
ascètes soufis,
bouddhistes zen, bouddhistes tibétains, hindous,
chrétiens, j'ai
pu parvenir à la certitude que des manières fort
différentes de s'exprimer recouvraient une
réalisation
intérieure très proche.
Sur ce point, je suis convaincu, même si je dois être
formellement
contredit par des théologiens. L'amour, c'est l'amour, et il
n'y a pas
lieu de distinguer l'amour chrétien de l'amour bouddhiste ou
de l'amour
soufi... Un être vit-il ou non en état d'amour du
prochain ?
Voilà, à cet égard, la seule question.
Ébloui par
l'amour que me portait, à moi, un inconnu, tel ou tel sage, je
ne me
suis pas soucié d'établir des distinctions entre
l'amour du soufi
et celui du maître zen au Japon.
La paix intérieure, c'est la paix intérieure, la
disparition de
la peur, c'est la disparition de la peur, la
sérénité,
c'est la sérénité, et partout l'on retrouve cet
effacement
d'une certaine affirmation individuelle permettant à un
autre niveau
d'être ou de réalité de se
révéler et de se
manifester.
Beaucoup de chrétiens considèrent cependant que
l'Église constitue le seul chemin vers Dieu. Ils se fondent
sur
certaines paroles du Christ, telles que "Je suis la voie, la
vérité, la vie", "Nul ne vient au Père que par
moi"...
Lesquelles se trouvent presque toutes dans
l'Évangile de
Saint Jean que je connais bien entendu depuis mon adolescence. Des
années durant, j'ai moi-même été
déchiré par cette constatation de l'existence de
différentes religions paraissant se contredire. Sans parler
de
souffrances ordinaires de l'existence, j'ai longtemps ressenti ce
problème de manière cruelle. Aujourd'hui, je
poserais la question
différemment : prenons le cas d'un chrétien qui,
rencontrant des
sages issus de différentes traditions, des soufis, des
hindous, des
Japonais ou des
Tibétains, acquiert la certitude que ces hommes ont atteint
un
degré de sainteté éblouissant,
évident,
rayonnant... D'autre part, force lui est de constater que
malgré ses
recherches, ses enquêtes, ses demandes, il ne rencontre pas
au sein de
notre christianisme actuel d'être de ce niveau, même si
parmi ceux
qu'il approche, certains chrétiens sont cependant
réellement
purifiés, transformés, sans
égoïsme...
Face à un homme ou une femme dont le rayonnement est
éblouissant,
lui sera-t-il possible de se dire en s'appuyant sur ces paroles de
Saint Jean :
"voilà quelqu'un à qui la vérité
échappe
puisque nul ne vient au Père que par moi et qu'il ne
confesse pas
Jésus-Christ"?
Les paroles du Christ n'auraient-elles pas un sens plus
intérieur et
plus subtil qui, s'il se révélait, montrerait d'une
part que le
Christ disait vrai et d'autre part que la vérité se
situe
au-delà des mots, des formulations et même de la
connaissance des
Écritures grecques ? N'étant pas moi-même
religieux, il ne
m'appartient pas de parler au nom de l'Église ; vous savez
cependant
comme moi que certains chrétiens et théologiens
d'aujourd'hui
tiennent l'ancienne formule "hors de l'Église, point de salut"
pour
totalement dépassée.
Quelques exemples illustres me viennent à l'esprit : Thomas
Merton, et
surtout le Père Le Saux, Swami Abhishiktananda, qui a
intensément
ressenti dans son être le déchirement du
chrétien face
à la splendeur de la sagesse hindoue. Il a reconnu comme
son
maître spirituel un hindou, Swami Gnânânanda,
que j'ai
d'ailleurs approché.
Il ne m'a pas été possible de m'entretenir avec lui
puisqu'il ne
parlait pas du tout anglais, mais je lui ai quotidiennement rendu
visite
pendant une dizaine de jours et en ai gardé un souvenir
émerveillé. J'ai lu la quasi-totalité des
écrits
publiés du Père Le Saux avec une admiration et une
gratitude
immenses, car après tant de recherches et de
déchirements, ce
témoignage d'un chrétien m'a été tout
à fait
précieux.
L'important, c'est que tout être humain comprenne que le
christianisme
n'a pas seulement une théologie et une morale à lui
offrir, mais
une vie nouvelle : la mort du vieil homme et la naissance de
l'homme nouveau.
Et cette expérience n'est pas reservée à
Saint Jean de la
Croix ou Sainte Thérèse d'Avila !
On parle sans cesse du christianisme, on prêche, on enseigne,
on publie
des livres sans jamais aborder le message essentiel : vous pouvez
vous-même découvrir par expérience la
présence de
Dieu en vous, l'amour de Dieu en vous, et ce "qu'être
sauvé"
signifie ! Une citation de Nietzsche me vient à l'esprit : "Je
croirai
au Rédempteur quand je verrai les chrétiens un peu
plus
rédemptés".
Voilà une parole terrible... Cette rédemption ne doit
pas
être réléguée après la mort, il
ne s'agit pas
seulement de savoir si notre âme ira en enfer ou au paradis ;
elle prend
place dans cette vie-ci à travers une transformation
intérieure
qui est en fait le message essentiel du christianisme.
Après un détour par l'Inde, le bouddhisme, les
monastères
zen et les soufis, cette insistance sur la transformation en
profondeur me
frappe à chaque ligne des Évangiles. Ayant fait
autrefois un peu
de grec au lycée, je suis capable de lire les
caractères grecs et
de chercher dans un dictionnaire, ce que je fais lorsqu'un passage
des
Évangiles ne me paraît pas du tout convaincant. Or, je
suis
toujours saisi de constater que la traduction française ne
donnait pas
toute la puissance du texte grec.
À une époque de ma vie, je me suis passionné
pour ces
problèmes et j'ai eu la possibilité de consulter des
théologiens qui étaient d'authentiques
hellénistes. Je
leur demandais : "Ne pourrait-on pas traduire de telle
manière tel mot
grec qui n'est pas traduit ainsi dans les différentes bibles
?" Ils me
répondaient affirmativement, et le changement de mot
donnait à la
parole un sens bien plus profond.
Ainsi, par exemple, lorsque le Christ interroge Pierre, lui
demandant à
plusieurs reprises : "M'aimes-tu ?" et que ce dernier répond
:
"Seigneur, tu sais bien que je t'aime !", le grec a recours à
deux
verbes dont la signification est différente (`philein' et
`âgapè'). Ce qui, en français, devrait donner
quelque chose
comme "M'aimes-tu, d'un amour libre et conscient ?" "Tu sais
bien que je
t'aime d'un amour limité et plein d'émotion"...
Donc, selon vous, pour qui veut s'en donner la peine,
l'enseignement du
Christ est applicable de nos jours ?
Je vais vous dire une
chose que je
ne mentionne pas souvent car elle ferait lever des réactions
inutiles :
je ne me considère ni hindou, ni bouddhiste, ni
musulman, mais tout
simplement chrétien. À ce propos, voici une
anecdote
très significative : on m'a récemment envoyé
du Canada une
énorme anthologie de textes spirituels de toutes les
traditions
réalisée par un ancien jésuite, Placide
Gabory, et
intitulée Un Torrent de silence, en me
précisant que j'y
étais cité.
Ce livre très intéressant d'ailleurs comporte des
chapitres
consacrés au Vedanta, à l'Islam, au judaïsme,
au
christianisme, etc. Sachant qu'y figuraient des extraits de mes
livres, j'ai
donc voulu voir ce qui avait été choisi et j'ai
cherché
à la rubrique "christianisme". Ne voyant rien d'Arnaud
Desjardins dans
ce chapitre, j'en ai d'abord conclu qu'on avait fait erreur et que je
n'étais pas cité. En fait, des passages de mes
ouvrages
figuraient effectivement sous la rubrique "Vedanta" !
En le découvrant je me suis dit : "Bien sûr ! Aux yeux
du public,
Arnaud Desjardins écrit des livres sur l'hindouisme..." Mon
maître
spirituel, auquel je me réfère, était en effet
hindou ;
mais dans ce que j'oserais appeler une certaine
naïveté, j'avais
d'abord cherché au chapitre "christianisme" car dans mon
for
intérieur, je me sens plus chrétien qu'hindou.
Pourquoi?
Parce que je suis occidental, que j'ai grandi dans le christianisme,
et que
pour échanger avec ceux qui m'entourent, il m'est plus
facile de me
référer au christianisme dont j'ai été
nourri. Ceci
dit, la Vérité est pour moi au-delà de toutes
les formes
dont on se sert pour l'exprimer et qui deviennent des limitations :
si
être chrétien signifie se sentir coupé de ceux
qui ne le
sont pas, je refuse une étiquette qui me limite au lieu de
m'ouvrir
à l'univers entier.
Aujourd'hui, un terme sacré comme le mot "gourou" est
employé
à tort et à travers, et a même plutôt
mauvaise
presse...
Oui... C'est comme ça.
Bien des individus se prétendent "gourou" et dispensent
un
"enseignement". Comment le chercheur sincère peut-il
dinstinguer le
maître de l'usurpateur ? Existe-t-il des critères
?
Cela se
ressent. Vient un moment où tout être sincère
devient tout
à fait capable de faire la différence. Chez tous les
gourous
véritables, célèbres ou obscurs, on retrouve
le même
désintéressement, une humilité même
au coeur des
honneurs ou des témoignages d'admiration, une
simplicité, une
totale absence de prétention... Je sais bien que l'on peut se
tromper au
début ; on porte en soi une espérance, et comme les
mécanismes de la projection et du transfert jouent encore
plus en ce qui
concerne l'éventuel gourou qu'envers le thérapeute
ou le
psychanalyste, on peut s'illusionner.
Certains considèrent des années durant tel ou tel
maître
spirituel mondialement célèbre comme leur gourou
pour finalement
constater que leur attitude intérieure face à leurs
peurs, leurs
désirs, leurs problèmes personnels n'a aucunement
changé.
Réfléchissez au fait qu'en allemand le mot
"Führer", par
lequel on désignait le chancelier Hitler, signifie "le guide".
Un
Français pourra d'ailleurs éprouver une impression
quelque peu
étrange en s'entendant dire dans un musée allemand
que le
"führer" sera là dans dix minutes...
Alors qu'il s'agit tout simplement du brave guide de service ! Et le
mot "duce"
en latin signifie également le "conducteur". On pourrait donc
très bien traduire aujourd'hui "duce" ou "führer" par
"gourou"...
À l'heure actuelle, à partir du moment où
quelqu'un
galvanise des millions de gens et prétend les conduire
à une vie
plus heureuse, on lui attribue le titre de gourou.
Cela peut conduire à de grandes illusions, et il n'est
effectivement pas
toujours facile, même pour une personne de bonne foi, de ne
pas
s'égarer. Mais celui dont la recherche est vraiment
sérieuse ne
se trompera pas très longtemps. Certains "gourous"
célèbres sont néfastes, d'autres sont
inoffensifs,
quelques-uns sont mêmes bénéfiques.
Par contre, votre question m'amène à dire que
l'hostilité
contre les sectes doit à mon avis être
extrêmement prudente.
Lorsque des milliers de jeunes ont trouvé une
espérance, un sens
à leur vie, et sont sauvés de la délinquance,
de la
drogue, de la violence, des perversions sexuelles, du
désespoir, il est
criminel d'attaquer ou de ridiculiser ce en quoi ils ont mis leur
espérance s'il ne s'agit pas d'un phénomène
véritablement dangereux.
Suite
|